ROUSSEAU : LE CONTRAT SOCIAL
- damienclergetgurna
- 6 nov. 2025
- 17 min de lecture
Dernière mise à jour : 30 nov. 2025
Depuis la fin des années 1970, on souligne, et le plus souvent pour le déplorer, la perte des "valeurs républicaines" . Mais de quoi s'agit-il au juste? Quelle(s) forme(s)revêt cette supposée crise de la République ? Pour tenter d'y voir clair, il vaut la peine d'opérer un petit détour par la lecture de cet ouvrage central et fondateur qu'est le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau.
L'ordre politique comme conquête de l'autonomie
L'idéal Républicain est un idéal antique. Ainsi y a-t-il eu une République romaine qui, même au temps de l'Empire, demeurait un idéal tenace. Contrairement à la démocratie qui désigne -avec l'aristocratie ou la monarchie -une façon de distribuer le pouvoir au sein de l'espace politique (en répondant à la question: qui va gouverner? Un seul? Plusieurs? Tous?), la République définit quant à elle une certaine manière de concevoir cet espace politique .En l'occurrence, dans une République, l'espace politique est classiquement défini comme un espace de liberté. Il est donc assez logique que la Révolution française se soit fortement inspirée de ce vieil idéal républicain, ressorti tout exprès des cartons pour abattre le joug de la «tyrannie».
Qu'est-ce que la tyrannie? À première vue, sans aucun doute, elle désigne l'exercice d'un pouvoir politique oppressif. Mais en réalité, l'oppression exercée par le tyran tient au fait que sont pouvoir n'a justement plus rien de politique. En traitant son peuple comme une armée d'esclaves à sa botte, le tyran transforme l'espace politique (qui est un espace de liberté) en un espace privatif: celui du maître de maison. Dans l'antiquité, l'esclavage était une institution exclusivement domestique, relevant de l'oikos (en grec)ou de la domus (en latin). La cité ne possédait aucun esclave, seule les personnes privées avaient des esclaves, qui étaient considérés comme des propriétés privés et qui, pour cette raison n'étaient pas protégés par la loi. Bref, avec la tyrannie, on sort de l'espace public (l'espace proprement politique), pour entrer résolument dans un espace privé. La tyrannie n'est donc pas l'exercice d'un pouvoir politique, mais l'exercice d'un pouvoir qui n'a plus rien de politique : «Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves, je n'y vois point un peuple et son chef: c'est, si l'on veut, une agrégation, mais non pas une association; il n'y a là ni bien public, ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier; son intérêt séparé de celui des autres, n'est toujours qu'un intérêt privé». (Le contrat social, I, 5.)
Qu'est-ce donc alors qui nourrit cette conviction que le domaine politique serait par définition un espace de liberté, et qu'il ne pourrait donc pas être autre chose sans disparaître aussitôt? Dans notre version républicaine, fortement inspirée de la philosophie rousseauiste, cette conviction procède d'abord du fait que l'ordre politique nous apparaît comme un domaine entièrement artificiel et fondé sur la libre volonté des hommes. En effet, le domaine politique n'existe pas en soi, naturellement. Car ce qui existe naturellement, ce sont des hommes dispersés aux quatre coins de l'espace et réunis par petits groupes (des bandes ou des hordes). La cité (Polis) n'est pas une donnée naturelle, ou un donné voulu par Dieu. Et en conséquence, le pouvoir politique n'est pas non plus un pouvoir naturel ou de droit divin. Il est un pouvoir institué par les hommes, pour les hommes, par le moyen de ce que l'on pourrait appeler un «contrat». De Hobbes à Rousseau, en passant par Locke, tous
les grands penseurs de la modernité politique ont fait reposer la fondation du domaine politique sur un «contrat social». Ça ne veut pas dire qu'un tel contrat a effectivement eu lieu, à l'origine, et de façon explicite. Ça veut dire simplement que tout ordre politique, du moment qu'il existe ,présuppose que les citoyens acceptent de façon implicite les termes de ce contrat tacite, même s'ils n'en ont pas conscience. Par exemple: un roi peut bien s'il veut se convaincre lui-même, et ses sujets, qu'il détient son pouvoir par la grâce de Dieu. Mais la vérité est qu'il ne dispose en réalité de ce pouvoir que parce que ses sujets acceptent collectivement et factuellement de se soumettre à lui...jusqu'au jour où ils refuseront de le faire et prendront les armes. Ce qui signifiera quoi? Qu'ils estimeront, à tort ou à raison, que le souverain a rompu les termes du contrat, et ils se sentiront alors déliés de toute obligation. D'où l'importance de chercher à clarifier les termes de ce contrat implicite, afin d'éviter les abus de pouvoir comme les révoltes illégitimes.
Deuxième point: quels sont les termes exacts de ce contrat social, qui institue le domaine politique (ou domaine public)? Pour Hobbes, la formulation de ce contrat était: «j'abandonne à tel homme ou à tel groupe de personnes ma liberté, afin d'obtenir ma pleine sécurité». Pour Locke, cette formulation était inexacte, car elle s'assimilait à un pacte de servitude que personne ne serait réellement prêt à signer. A la base de l'instauration d'un ordre politique, il y aurait alors un autre genre de contrat: «j'abandonne à tel ou tel groupe de personnes ma liberté naturelle, afin qu'ils protègent ma propriété privée (ma vie étant considérée comme ma première propriété)». Déjà, sous cette formule, les termes du contrat civil garantissent ma liberté. Mais ce n'est pas la liberté du citoyen, c'est la liberté du propriétaire, une liberté «privée». Pour Rousseau, cette formulation du contrat ne convient pas non plus. Car elle suppose acquis un droit naturel de propriété, incontestable et sacré. Il est vrai que cette façon de formuler le contrat est sans doute à l'avantage du grand propriétaire ou du grand notable, qui ont tout intérêt à voir leur bien garanti et protégé par la puissance publique. Mais tous les pauvres, qui constatent avec amertume que certains en tout alors qu'eux n'ont rien, ne seraient pas forcément partisans d'un tel contrat. Pour eux, ce serait un contrat de dupes, qui les inciterait à renoncer à leur liberté naturelle (leur indépendance) pour accepter le joug légal d'une insupportable servitude sociale.
Il va de soi que si l'espace politique est un espace «public», qui s'étend à tous, alors tout le monde doit pouvoir s'y retrouver et y trouver son compte. Le problème est donc le suivant: «Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant». Pour que l'espace public soit réellement public, il ne suffit pas en effet qu'il étende son autorité sur tous. Il faut qu'il appartienne à tous, qu'il soit un espace commun, et non pas un espace accaparé par quelques uns. Ce pourquoi le contrat qui institue cet espace ne peut absolument pas revêtir la forme d'un contrat de sujétion, où les individus accepteraient de se soumettre à la volonté souveraine d'une personne ou bien d'un groupe de personnes. Dans de telles conditions, nul n'accepterait de céder sa liberté naturelle (son indépendance). Ce pourquoi la formule du contrat social ne peut être: «j'accepte de me soumettre à la volonté de celui-ci ou de ceux-là», mais plutôt: «j'accepte de me soumettre à la volonté «commune» (ou volonté «générale»). Ce n'est qu'à ce prix que chacun, en acceptant de renoncer à sa volonté propre, ne renonce pas pour autant à sa liberté. En se soumettant à la volonté commune il ne se soumet finalement à la volonté de personne, mais à la sienne propre en tant qu'il est membre de la communauté.
Toute la question est alors de savoir comment cette volonté générale peut exister. Car la volonté générale ne peut pas résulter de la simple addition des volontés individuelles, dont on ferait ensuite la moyenne pour tirer de là une tendance majoritaire. On peut, il est vrai, choisir de suivre cette règle de la majorité quand une décision doit être prise. Mais encore faut-il d'abord que cette règle de la majorité soit acceptée par tous. Sans quoi, elle n'aura pas force de loi. Par exemple, lorsqu'un président est élu à la majorité, chacun accepte en principe que même s'il n'a pas voté pour lui, ce président n'en est pas moins légitimement élu et qu'il a donc le devoir de le reconnaître. Si l'on n'acceptait pas cette règle de la majorité, alors on pourrait se dire que ce président n'est pas le notre parce qu'on n'a pas voté pour lui. Sous cette volonté du plus grand nombre (celle qui a élu le candidat), il doit donc impérativement y avoir une volonté «générale», «commune» et qui n'excepte aucun citoyen. Sans doute les citoyens n'ont pas voté comme un seul homme (puisqu'il y a eu dissension dans la répartition des votes), mais ils se sont mis d'accord, comme un seul homme, sur les règles de l'élection. C'est cela que Rousseau nomme la volonté générale et que l'on invoque lorsqu'on parle de certaines décisions comme voulues par le peuple. Cette volonté générale, une et non pas diverse, est ce qui confère au corps politique une existence parfaitement propre et autonome. Il n'y a un peuple, une nation, une cité, que parce que -au-dessus des volontés individuelles ou de leur simple addition -a émergé quelque chose de tel qu'une volonté commune: «cet acte d'association produit un corps moral et collectif, composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique, qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres, prenait autrefois le nom de cité, et prend maintenant celui de république ou de corps politique». En somme, la République est «une» et «indivisible».
Mais l'on n'a toujours pas répondu à la question: comment une telle volonté commune est-elle possible? Comment, à partir de volontés individuelles, forcément multiples, pouvons-nous produire quelque chose de tel qu'une volonté commune (et donc constituer une République)? A vrai dire, la réponse est assez simple, mais elle suppose de chacun une énorme ascèse personnelle. Pour que tous veuillent la même chose, il faut que chacun consente à faire abstraction de ses intérêts et privilèges particuliers, afin de voir les choses sous l'angle de ce Tout que représente la République. Chacun doit donc dépouiller sa propre existence individuelle, avec ses désirs particuliers, ses croyances particulières, ses traditions et appartenances singulières, afin de ne se considérer que comme un membre de cette République une et indivisible. Il doit abandonner les oripeaux de l'homme naturel, pour revêtir la dignité nouvelle du citoyen. Au lieu de se voir différent des autres, ayant ce que les autres n'ont pas ou n'ayant pas ce que les autres ont, il doit au contraire se considérer comme entièrement identique à eux: un citoyen comme un autre. Sans un tel renoncement, il ne peut pas y avoir de volonté commune, et par conséquent ne peut pas non plus exister cette personnalité morale (par opposition à une personne physique) que nous nommons une Cité ou une République. Raison pour laquelle Rousseau en fait l'unique clause du contrat social: «Les clauses [de ce contrat], bien entendues, se réduisent toutes à une seule: l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté».
C'est de ce renoncement intégral à soi(au profit de la communauté) que résultent les trois grandes devises républicaines: Liberté, Égalité, Fraternité. Sans un tel renoncement à soi, aucune de ces devises n'aurait le moindre sens. Rousseau l'explique particulièrement bien. Egalité: «Chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous; et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres.». Fraternité: «L'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer». Liberté: «Chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquière le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a»
Reste une question importante: quel bénéfice personnel pouvons-nous attendre de cet état civil, qui nous transforme en citoyen? Qu'avons-nous à gagner à consentir à une telle ascèse qui fait de nous un patriote, faisant passer le service de la République avant tout autre intérêt ? Rien de moins que la liberté. Pas cette liberté naturelle que nous avons, et qui n'est que l'indépendance à l'égard des autres. Une indépendance toute relative, du reste, puisque ce goût pour l'indépendance revêt -au contact des autres- l'allure d'un amour-propre fasciné par leur regard. La sphère politique nous introduit au contraire dans un espace de liberté qui se nomme «autonomie», capacité à se fixer à soi-même des lois et à y obéir. Une liberté morale, donc, qui est la vraie liberté conquise par le citoyen: «Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que, la voix du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme»
La religion civile et le problème théologico-politique
On comprend dès lors en quoi ce domaine politique (la République: res publica: chose publique) revêt également une lourde dimension polémique. Car si cet espace est le lieu de l'autonomie, il est directement opposé à un régime de l'hétéronomie, tel qu'il se donne à voir dans la constitution traditionnelle des sociétés religieuses. Le domaine politique rentre en concurrence avec le domaine religieux, précisément sur cet enjeu fondamental de la liberté. C'est à l'intérieur de ce cadre qu'il faut comprendre le fameux «problème théologico-politique», qui joue un rôle central dans la définition de l'idéal républicain. Dans la mesure où la croyance religieuse repose sur une hétéronomie assumée (la soumission à la parole de Dieu), elle ne saurait qu'entrer logiquement en contradiction avec un domaine politique tout entier construit sur l'autonomie des citoyens. Mais cette tension devient radicale lorsque la croyance religieuse prétend assumer un rôle politique. Tel est le cas, par exemple, des systèmes théocratiques (exemple: la «république islamique») où la religion prétend absorber en elle tout l'espace politique... en faisant du même coup disparaître ce que cet espace a de proprement «politique».
Mais dans l'histoire politique occidentale, cette tension a pris une autre forme. Le problème théologico-politique s'y énonçait comme le problème de la relation entre l'Eglise et l'Etat. Car l'Eglise, contrairement à la religion (qui désigne une croyance), est une institution sociale particulière, organisée et hiérarchisée, avec son administration propre (la «curie»), ses fonctionnaires (les «prêtres»), son peuple (le peuple des «fidèles») et ses cérémonies publiques(le culte). A ce titre, elle constitue -au sein du corps politique -une puissance sociale toujours susceptible de rentrer en conflit avec le pouvoir souverain. L'allégeance du fidèle catholique au pouvoir de Rome vient doubler son allégeance -en tant que citoyen -au corps politique auquel il appartient. A qui ira donc sa fidélité si un désaccord survient entre les deux?
Depuis Saint Augustin, toute la théologie chrétienne a répondu à cette contradiction en distinguant nettement la «Cité des hommes» (la cité politique) et la «Cité de Dieu» (la République chrétienne), afin qu'il n'y ait aucun risque d’empiétement entre les deux et qu'ils puissent vivre en bonne entente. Il s'agissait par là de suivre le précepte évangélique de «rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu». Comment concevoir pratiquement cette séparation de l'Eglise et de l'Etat? En accordant à l'Eglise un simple «pouvoir spirituel» et à l'Etat un «pouvoir temporel»(ou «séculier»), à qui seul est réservé l'usage de la force publique. Le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat n'a donc rien de spécifiquement républicain. Au contraire, il est un principe éminemment chrétien. Mais la logique même d'un tel principe suppose en théorie qu'il n'y ait pas d'empiétement possible entre les deux instances et que, par conséquent, la croyance religieuse ne vienne pas se constituer en une force temporelle efficace et rivale.
Dans ce cas, on peut dire que l'existence même de l'Eglise, institution sociale, pose un sérieux problème. Car cette institution, disposant d'un grand nombre de membres et de ressources matérielles considérables, organisée hiérarchiquement, constitue de fait, une puissance sociale. Une puissance d'autant plus redoutable pour la République qu'elle prétend opposer à la force de la volonté générale l'autorité d'une force supérieure (Dieu). Comme l'écrit Rousseau: «Tout ce qui rompt l'unité sociale ne vaut rien; toutes les institutions qui mettent l'homme en contradiction avec lui-même ne valent rien». Par conséquent, pour que la séparation entre le temporel et le spirituel puisse avoir réellement du sens, il faut impérativement que la croyance religieuse se désolidarise de toute structure ecclésiale. Les assemblées de prière, les prêtres, la curie, les fidèles et toute la discipline de groupe qui assure la cohésion de la société ecclésiale... tout cela doit être ôté de la croyance religieuse afin que cette dernière n'exerce plus d'influence autre que spirituelle. Ce qui revient à transformer en profondeur la foi chrétienne, en faisant d'elle une pure adhésion intérieure, sans référence aucune à la pratique sociale d'un culte, à l'appartenance à une association ou à l'obéissance à une autorité institutionnelle. Mieux encore: au lieu d'être l'attestation d'une hétéronomie assumée (puisqu'il s'agit de se soumettre à une vérité reçue: un «dogme»), cette croyance doit devenir la manifestation de notre liberté (puisqu'il s'agira désormais de choisir librement, dans cette vérité reçue, ce que l'on veut croire et ce qu'on ne veut plus croire). De cette redéfinition de la croyance religieuse (et du pouvoir spirituel qui l'accompagne), Rousseau est le témoin le plus éloquent et pour ainsi dire, le génial thuriféraire. Cette religion «sans temples, sans autels, sans rites, bornée au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale, est la pure et simple religion de l'Evangile». Ce qu'il décrit là est un phénomène qui n'a cessé de progresser depuis le 18e siècle et que l'on peut décrire comme le triomphe de la «spiritualité» en lieu et place de la vieille «croyance religieuse».
Cette séparation du spirituel et du temporel, de la croyance religieuse et du domaine politique, pourrait paraître à première vue un acquis définitif de la République. Pourtant, et c'est ce que montre Rousseau, une telle séparation ne saurait être longtemps tenable. Que vaut en effet un pouvoir temporel qui n'aurait pas en même temps l'ambition de revêtir une dimension spirituelle? Ou que vaut réellement une obéissance civique qui s'arrêterait devant l'éventualité du sacrifice ultime? Pour que quelqu'un accepte de «sacrifier» sa vie, il faut nécessairement que ce pour quoi il accepte de se sacrifier lui apparaisse comme une cause «sacré»». Sacré et sacrifice, même étymologie. Dès lors, si la volonté générale doit être tenue pour «sacrée», si la Liberté du Peuple doit devenir une cause «sacrée» justifiant que les citoyens consentent sacrifier leur vie, elle doit impérativement recevoir une caution religieuse. Avant que le christianisme ne propose de distinguer le Spirituel et le Temporel, c'est d'ailleurs ainsi que les choses se passaient ordinairement: les dieux étaient au service d'un ordre social qu'ils servaient à justifier. On allait se faire tuer pour Pharaon, parce que pharaon était un dieu. On respectait scrupuleusement le système des castes, parce qu'il reproduisait la hiérarchie céleste des dieux indiens.... En France, lorsque «le roi très chrétien», soumis d'abord à l'Eglise, devint ensuite un «roi de droit divin» tenant directement de Dieu sa propre autorité, c'est exactement à cette réappropriation du pouvoir spirituel par le pouvoir temporel que nous avons assisté. Mais dans tous ces cas, la croyance religieuse servait à légitimer un ordre social qui n'avait rien de républicain. Cela se comprend aisément, du reste : puisque la croyance religieuse est intellectuellement un acte de soumission à une vérité révélée, elle tend naturellement à servir de caution à un ordre social fondé sur le même type de soumission à une autorité extérieure. Autrement dit, l'hétéronomie religieuse est le meilleur garant de l'hétéronomie sociale. Ce pourquoi les révolutionnaires français s'opposaient conjointement au roi et à l'Eglise catholique.
Mais cette similitude de structure entre l'hétéronomie religieuse et l'hétéronomie sociale, si elle rend très facile le passage de l'une à l'autre, ne la rend cependant pas inévitable. A vrai dire, cette opposition entre autonomie et hétéronomie , entre une norme qu'on se donne à soi-même et une norme que l'on reçoit de l'extérieur, peut être facilement surmontée si nous examinons ce qu'est une norme morale, une loi . A première vue, on peut penser qu'il n'y a rien de commun entre le commandement religieux et une loi qu'on se donnerait à soi-même. Rien de commun sinon ce fait que dans les deux cas il s'agit d'une prescription qui nous fait un devoir d'agir de telle ou telle manière. Or, cette notion de loi peut être envisagée sous deux angles différents : si elle est comprise comme une loi qu'on se pose à soi-même, il n'en demeure pas moins que, une fois posée, cette loi nous oblige. Que serait une loi qui n'aurait pas le pouvoir de nous obliger ? Dès lors, c'est exactement comme si cette loi s'imposait à nous de l'extérieur, nous forçant à faire ce que nous n'avons pas forcément envie de faire, c'est-à-dire : notre devoir . C'est nous qui avons choisi cette loi (principe d'autonomie), mais à partir du moment où elle vaut comme une loi, elle prend un caractère obligatoire qui semble parfaitement indépendant de nous (principe d'hétéronomie). On peut aussi considérer les choses sous l'angle inverse : si la loi s'impose à nous de l'extérieur (principe d'hétéronomie), elle ne peut avoir le pouvoir de nous obliger vraiment que si nous acceptons auparavant de la reconnaître comme valide, exactement comme si elle venait de nous et qu'en lui obéissant nous ne faisions en somme que nous obéir à nous-même (principe d'autonomie). Ainsi la distinction entre hétéronomie et autonomie est facilement surmontable dès que nous nous efforçons d'en rendre compte à partir de l'analyse du concept de loi . Du même coup, il n'y aurait rien de particulièrement scandaleux à tenir certaines valeurs politiques pour des valeurs sacrées , de nature proprement religieuses, même si nous reconnaissons par ailleurs que ces valeurs n'ont d'autre fondement qu'en nous-mêmes
Rousseau cite en exemple les Républiques de l'antiquité (les cités grecques et la république romaine), qui reposaient sur une religion civile. Sans cette religion civile, jamais une telle dévotion héroïque au salut de la République n'aurait été possible. De cette religion civile, Rousseau écrit qu' «elle réunit le culte divin et l'amour des lois, et que, faisant de la patrie l'objet de l'adoration des citoyens, elle leur apprend que servir l'Etat, c'est en servir le dieu tutélaire. (...) Alors mourir pour son pays, c'est aller au martyre; violer les lois, c'est être impie; et soumettre un coupable à l'exécration publique, c'est le dévouer au courroux des dieux». Ce précédent justifie amplement qu'on puisse alors parler d'une sacralité républicaine. Rousseau en dessine les contours dans les dernières pages du Contrat social: «Il y a donc une profession de foi purement civile dont il appartient au souverain de fixer les articles, non pas précisément comme dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabilité sans lesquels il est impossible d'être bon citoyen ni sujet fidèle. Sans pouvoir obliger personne à les croire, il peut bannir de l'Etat quiconque ne les croit pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme insociable, comme incapable d'aimer sincèrement les lois, la justice, et d'immoler au besoin sa vie à son devoir.» .
En résumé, il ne suffit pas que la République lime les dents du pouvoir religieux en désolidarisant la croyance religieuse de toute institution ecclésiale et en faisant donc d'elle une affaire strictement privée. Dans le même temps, elle doit aussi s'armer «spirituellement» en devenant elle-même une véritable institution ecclésiale, avec ses dogmes, ses rites, ses fonctionnaires et ses fidèles. Conjoindre la mystique du salut éternel à la cause de la Nation, fondre la dignité consacrée du prêtre dans la figure laïque de l'instituteur, transformer les mairies en nouvelles églises, décliner la liste des martyrs de la république comme une nouvelle litanie des saints, conférer aux droits de l'Homme et du citoyen le statut des tables de la loi que Moïse a ramené du mont Tabor.... Telle était l'immense puissance conférée au domaine politique, domaine de la «chose publique» (Res-Publica)
La fin de la mystique républicaine
La crise de l'idéal républicain se mesure d'abord à l'essoufflement de cette sacralité républicaine, qui paraît très souvent une cérémonie vide de sens. Se sacrifier pour le salut de la chose publique, qui d'entre nous s'y résoudrait encore ? Faire passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier, se vouloir citoyen plus que tout autre chose, qui sincèrement le voudrait?
Dans un petit livre paru en 1998, La religion dans la démocratie, le philosophe Marcel Gauchet proposait une hypothèse pour expliquer cette curieuse perte de puissance du politique: «Nous sommes sortis de l'ère d'une autonomie à conquérir contre l'hétéronomie. Cela parce que la figure de l'hétéronomie a cessé de représenter un passé toujours vivant et conséquemment un avenir toujours possible. L'intégration des religions dans la démocratie est consommée; le catholicisme officiel lui-même, si longtemps réfractaire, a fini par s'y couler et par en épouser les valeurs. (...) la politique a perdu l'objet et l'enjeu qu'elle devait à son affrontement avec la religion. Invisible et brutale, une onde dépressive surgie vers1970 a entraîné la révision drastique des objectifs à la baisse, à tel degré que les espoirs investis hier encore dans l'action collective nous sont devenus proprement incompréhensibles. (...) Rien ne pourra restituer leur ancienne énergie spirituelle au sacerdoce du citoyen, à la majesté morale de l'Etat, aux sacrifices sur l'autel de la chose publique. Ces instruments cultuels ont irrémédiablement perdu leur fonction. Plus n'est besoin de dresser la cité de l'homme à la face du ciel».
Expliquons en quelques mots l'hypothèse de Gauchet: finalement, la perte de puissance de la mystique républicaine serait à comprendre de la même façon que la perte de puissance du christianisme. Cette impuissance n'est pas le signe d'un échec, mais au contraire le signe d'une victoire trop complète et trop éclatante. L'ardeur des premiers chrétiens persécutés aux premiers siècles après Jésus Christ n'a rien à voir avec la foi de ces chrétiens installés que décrivaient Montaigne au 16e siècle, et qui pouvaient se dire chrétiens comme on se dit berrichon ou périgourdin. Sans ennemi à vaincre, le christianisme a tout simplement perdu sa flamme. La même chose serait finalement arrivée à la République. Le parti de l'hétéronomie (la réaction) qui avait longtemps tenu en alerte la combativité du camp républicain a été totalement vaincu. L'Eglise catholique, si longtemps alliée de la droite légitimiste, a elle-même fini par se rallier totalement aux valeurs républicaines. Dès lors, la république n'est plus une cause pour laquelle il faudrait encore combattre; elle est devenue une rente sur laquelle nous sommes installés.



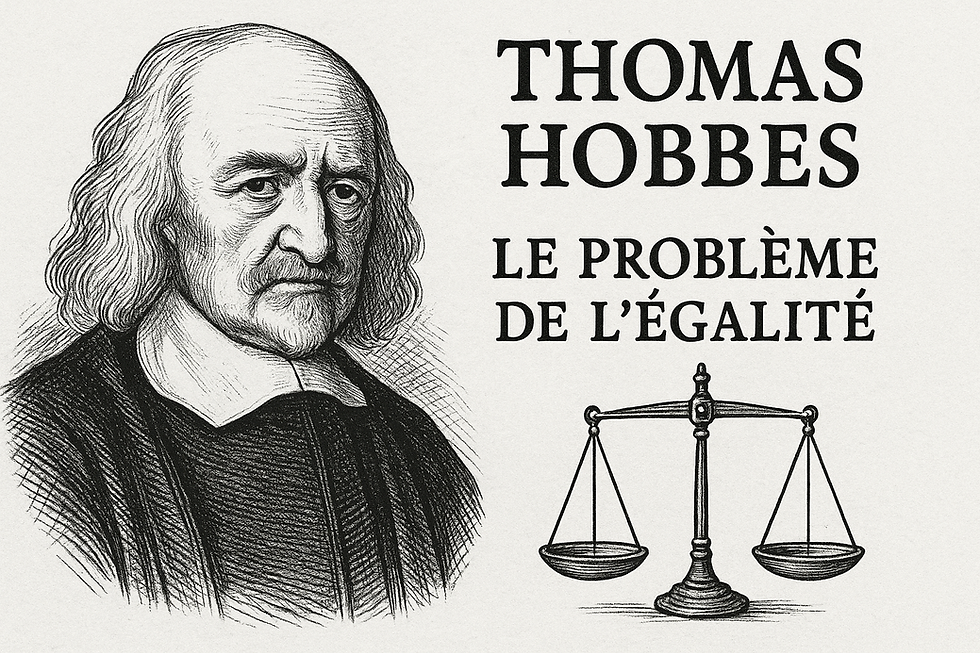


Commentaires