LE DÉLIT D'OPINION
- damienclergetgurna
- 27 oct. 2025
- 9 min de lecture
Dernière mise à jour : 30 nov. 2025
La lutte contre les "discours haineux" semble, du moins à première vue, avoir restauré dans les sociétés occidentales modernes le principe ancien du délit d'opinion. Une personne devient condamnable non point tant pour les actes délictueux qu'elle aurait commis que pour l'expression d'une opinion qui serait conçue comme intolérable. Qu'on puisse ainsi vouloir limiter l'expression publique de certaines opinions est en soi compréhensible. Mais à partir de quel moment doit-on estimer que l'existence de ce "délit d'opinion" devient une atteinte intolérable à la liberté d'expression ? Intellectuellement, il est en effet plus aisé de défendre le principe d'une liberté d'expression sans limite que d'y introduire des limites, dont la frontière parait toujours désagréablement négociable au gré des susceptibilités des uns et des autres. Se réfugier derrière le mot d'ordre libéral ("ma liberté s'arrête là où commence celle des autres") est d'un maigre secours en la circonstance, puisque l'expression d'une opinion, quelle qu'elle soit, ne vient interférer avec la liberté de personne, et surtout pas avec notre liberté de n'y pas souscrire. Essayons donc d'y voir un peu plus clair, pour discerner dans quelle mesure la liberté d'opinion pourrait être limitée, sans pour autant être niée.
Condorcet : Éducation ou instruction
Cette question, on peut la traiter à travers une autre question qui est celle du rôle de l'École dans des institutions républicaines. S'il existe en effet des opinions consacrées et des opinions que nous n'avons pas le droit d'exprimer, alors l'Ecole doit assumer le rôle de transmettre aux enfants les opinions autorisées et d'étouffer dans l'œuf celles qui seraient inadmissibles. C'est dans le contexte de ce questionnement qu'il faut lire les Cinq mémoires sur l'instruction publique de Condorcet, rédigés au lendemain de la Révolution française. Le premier de ces cinq mémoires est consacré explicitement à la question brûlante de savoir comment définir le rôle éducatif de l'État.
S'agit-il d'instruire ou bien d'éduquer les futurs citoyens? Instruire, cela signifie pour Condorcet transmettre des vérités établies, vérités de fait ou bien vérités de calcul ; éduquer engage d'aller plus loin, en transmettant un certain nombre d'opinions fondamentales pour le corps politique (des croyances politiques, morales ou religieuses), mais qui n'ont pas cependant le statut de vérités établies. L'État a-t-il le droit d'assumer une telle fonction, interroge Condorcet ? La réponse qu'il défend est une réponse négative : Le but de l'école doit être d'instruire, exclusivement, et non pas d'éduquer.
En effet, dans la mesure ou aucune croyance politique, morale ou religieuse ne peut avoir le statut de vérité établie, on ne peut les enseigner dogmatiquement comme des théorèmes mathématiques ou comme des lois de la physique. Prétendre le faire, ce serait , argumente Condorcet, porter lourdement atteinte à la liberté d'opinion. Certes, dans l'esprit de ceux
qui aimeraient transformer le ministère de "l'instruction publique" en un ministère de "l'éducation nationale" , l'enseignement d'une philosophie officielle permettrait de lutter efficacement contre la puissance aliénante des préjugés familiaux, et donc de libérer les esprits asservis. Loin de voir dans cette volonté éducative une oppression, ils y voient donc plutôt un projet émancipateur.
Ce serait effectivement le cas, souligne Condorcet, si ce que l'on se proposait de mettre à la place des préjugés politiques et religieux des enfants était bien une vérité indiscutable, autrement dit si cette éducation morale résultait directement des bénéfices d'une instruction. Mais en ce cas, à quoi bon prendre la peine d' "éduquer" s'il suffit à l'Ecole républicaine, pour abattre ces préjugés, d'assumer sa fonction ordinaire d'instruire les enfants ? Par exemple (ce n'est pas un exemple que prend Condorcet), on pourrait estimer que la meilleure façon de lutter contre le "racisme" passe par une instruction en bonne et due forme (expliquer aux enfants l'usage et les limites exactes du concept de "races" en biologie), plutôt que par un cours d'éducation civique.
Soit la position "éducative" est inutile, soit elle est franchement néfaste. En effet, en assumant une tâche éducative, le risque le plus important est que l'école en vienne à présenter comme une vérité indiscutable (en s'abritant derrière son rôle d'instructeur) ce qui n'est tout au plus qu'une opinion officielle. Il s'agirait alors pour elle de prendre appui sur l'autorité que confère au professeur la maîtrise d'un savoir indiscutable pour faire passer en force une opinion qui n'a plus rien d'un savoir. Ce procédé est gros d'un immense danger : outre qu'il relève de la manipulation pure et simple, il risque par réaction de rendre incertain et douteux, dans l'esprit des enfants, les vérités les mieux établies. À vouloir se servir de son rôle d'instructeur pour appuyer son ambition éducative, l'école républicaine risque bel et bien de décrédibiliser complètement le savoir qu'elle a vocation à transmettre. Rien de pire pour l'intelligence humaine que de voir ainsi s'effacer la frontière qui devrait séparer pour elle le domaine de la science et celui de la croyance.
Pire encore, observe Condorcet : du point de vue de la liberté d'expression , le poids des préjugés familiaux et communautaires est nettement moins à craindre que le poids d'une opinion qui serait cautionnée et défendue par l'État. On peut en effet facilement échapper aux uns (il suffit tout simplement d'aller voir ailleurs), mais il sera inévitablement très difficile d'échapper à l'autre! Les circonstances de la vie amènent naturellement un enfant à sortir de sa sphère familiale, à subir d'autres influences, à rencontrer au cours de son existence d'autres façons de penser. Les préjugés auxquels il adhère sont donc soumis à la variabilité imprévisible de ces rencontres. Mais il est en revanche pour chacun beaucoup plus délicat d'échapper à une opinion qui aurait pour se diffuser et pour s'imposer tous les organes de diffusion de la machine étatique. On échappe plus facilement au discours des parents qu'à celui de l'autorité souveraine. Si donc il s'agit de nous libérer de nos opinions, mieux vaut que l'Etat ne se mêle pas d'imposer la sienne.
Il ne s'agit pas seulement, pour Condorcet, de défendre la liberté d'opinion pour elle-même. En l'occurrence, cette liberté est aussi la meilleure garantie que nous puissions aussi offrir au droit de la vérité à prévaloir toujours et partout. Dans les anciennes sociétés, note Condorcet, le préjugé public jouait un rôle fédérateur en ce qu'il permettait de garantir la cohésion sociale. L'ordre politique n'était donc pas subordonné à une exigence de Vérité mais à une exigence d'unité sociale. Or, ce qui définit le siècle des Lumières, c'est bel et bien le désir de consacrer le droit de la vérité à prévaloir sur toute institution fondée sur la superstition, le mensonge ou l'ignorance. La meilleure façon de garantir ce droit de la vérité, c'est de maintenir un sain pluralisme qui permettrait à chacun d'exposer ses idées et de les défendre devant les autres. L'espace public, en étant le garant de ce pluralisme d'opinion, permet seul à la vérité d'émerger.
A contrario, en imposant une opinion officielle , même si celle-ci porte sur des valeurs politiques ou morales fondamentales (par exemple : la tolérance, la laïcité...) ,le pouvoir politique lèse les droits de la vérité en fermant la porte à toute discussion publique.
Kant : usage privé et usage public de la raison
A certains égards, la thèse défendue ici par Condorcet ressemble beaucoup à celle que défend son contemporain, Emmanuel Kant, dans Qu'est-ce que les Lumières?. Kant aussi défend le principe d'une liberté d'expression, comme condition d'accès à la vérité.
Toute vérité ne relève pas d'un dialogue et d'un échange d'opinions. Certaines vérités s'obtiennent par simple démonstration ou par vérification empirique, et n'ont donc aucun besoin d'être discutées sur la place publique. En mathématiques, par exemple, on ne discute pas; on démontre. Telle est la nature de ce que Kant, dans la Critique de la faculté de Juger, nomme un jugement déterminant , par lequel on subsume une cas particulier sous une vérité générale qui est déjà reconnue et disponible. Le syllogisme d'Aristote ( Tous les hommes 12 sont mortels, Socrate est un homme; donc, Socrate est mortel ) n'a aucun besoin d'être soumis à discussion publique pour être reconnu vrai.
En revanche, il n'en va pas de même pour ce que Kant nomme le jugement réfléchissant , qui consiste à prononcer un énoncé sur un cas particulier (par exemple : ce tableau est beau ), sans qu'aucune vérité générale ne soit reconnue au préalable, sous laquelle on pourrait subsumer par avance ce cas particulier. Comment savoir si ce tableau est beau, si l'on ne dispose d'aucune vérité générale indubitable concernant la nature du beau ? Dans ces conditions, il n'y a d'autres solutions, pour parvenir à dépasser le désaccord, que de jouer les règles du dialogue socratique. Il ne sert à rien de discuter, dit Kant, si on n'a pas l'espoir de s'entendre .
Toutefois, il y a un point sur lequel Kant se distingue nettement de Condorcet, et qui concerne la légitimité politique d'un projet éducatif. Contrairement à Condorcet, Kant ne considère pas que l'État commettrait une erreur en se faisant éducateur . Car toute société a besoin, pour exister, d'un petit nombre de croyances fondamentales et partagées, sans lesquelles elle ne saurait aucunement subsister. Même une société républicaine, qui défend le principe du pluralisme, a au moins besoin pour exister de faire partager à tous les valeurs de la République . Sans quoi, au nom même du respect de la liberté d'opinion, on pourrait se croire justifié à remettre en cause les valeurs qui garantissent cette liberté d'opinion. Pour le dire autrement : l'intolérance peut toujours logiquement se servir du principe de la tolérance pour revendiquer son droit à exister!
Par conséquent, il importe que certaines opinions soient politiquement tenues pour des vérités indiscutables, qu'aucun membre de la communauté ne saurait remettre en cause sérieusement sans rompre le pacte politique. Mais dans ce cas, comment concilier ce principe avec le droit reconnu à chacun de penser par soi-même? Chez Kant, la solution à ce problème passe par une distinction nette entre l'usage public et l'usage privé de la raison. En tant qu'il est membre d'une communauté familiale ou politique, l'individu demeure nécessairement soumis aux normes qui permettent à cette communauté d'exister et de fonctionner correctement. En tant que fonctionnaire, un professeur a donc le devoir de transmettre à ses élèves, comme vérités établies, des opinions déterminées (par exemple, le principe de la laïcité). Mais en tant qu'il est aussi membre d'une société cosmopolite, incluant tous les hommes et toutes les époques, l'individu a le droit de faire usage de sa raison comme il l'entend, sans être contraint d'aucune sorte, en exprimant son opinion sur la place publique ( la république des Lettres ) pour qu'elle soit appréciée et discutée.
Par cette distinction entre usage privé et usage public, la cohésion sociale reste préservée sans que les droits de la vérité ne soient pour autant menacés. Il faut toutefois remarquer que la distinction kantienne ne correspond pas à notre usage et que cette différence ne manque pas d'être révélatrice d'une certaine évolution de nos mentalités. Pour nous, en effet, ce serait plutôt l'usage privé de la raison qui devrait être tenu pour libre, tandis que l'usage public, lui, doit demeurer contenu. Pour nous, un homme qui se prononce comme simple particulier, afin d'exprimer son opinion sur un enjeu social, fait usage de sa liberté d'expression. Mais c'est évidemment un usage privé , en tant que simple particulier. Si le même discours était tenu par le même individu lorsqu'il occupe une responsabilité publique (en tant qu'officier, professeur, prêtre...), ce discours pourrait être considéré à juste titre comme fautif. Kant ne dit pas autre chose....mais il inverse la signification des mots "privés" et "publics". Pourquoi?
Réponse : parce que, pour lui, le particulier qui fait usage de sa raison ne doit surtout pas le faire en tant que simple particulier , mais en tant que membre putatif d'une société cosmopolite, en tant que "citoyen du monde" . Et cela fait une différence énorme! Si notre liberté d'expression n'engageait en effet que notre droit à penser ce que nous voulons, comme simple particulier, défendre cette liberté d'expression ne serait rien d'autre en fait que défendre les droits de la propriété privée. Chacun aurait alors le droit de penser et de dire ce qu'il veut, à titre privé, comme il a le droit de tondre son gazon ou de se marier s'il en a envie. Mais pour qu'une opinion soit discutée, pour qu'elle soit débattue, pour qu'on puisse la soumettre à un examen, il ne faut surtout pas qu'elle demeure cantonnée dans la sphère privée; il faut au contraire qu'elle puisse apparaître publiquement, sur la scène publique, aux yeux et au su de tous. Ce que fait justement un écrivain lorsqu'il publie un ouvrage ou un intellectuel lorsqu'il rédige une tribune dans un journal.
En somme, tout dépend de ce à quoi nous faisons servir la liberté d'expression. Est-elle un moyen d'accéder à la vérité? Et dans ce cas, la liberté d'expression doit impérativement relever d'un usage public de la raison. Ou bien n'est-elle qu'un moyen de faire valoir le droit qu'aurait chacun de penser ce qu'il veut sans en être empêché, même par les normes de la Raison humaine? En ce cas, il suffit effectivement de faire de sa pensée un usage strictement privé et de revendiquer ce droit comme un droit de même espèce que celui que nous possédons par ailleurs sur notre propre corps; chacun étant tenu alors de respecter ces opinions- même si elles sont absurdes- parce qu'elles seraient porteuses, comme notre corps, de notre identité personnelle. Ce n'est plus l'idéal républicain qui prévaut alors, mais sa version libérale...




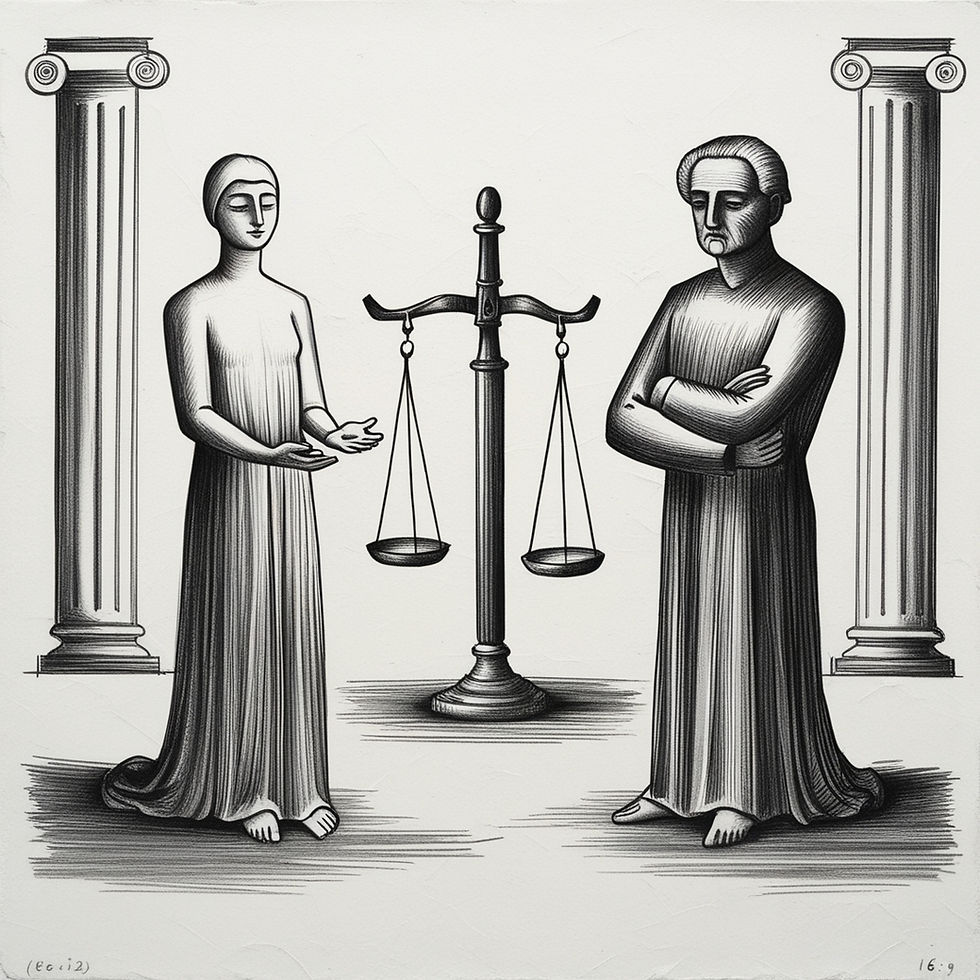

Commentaires